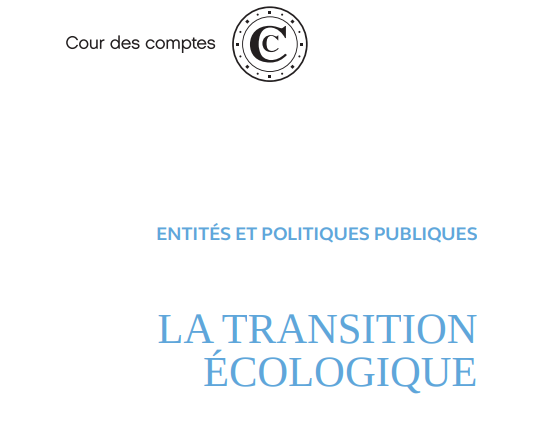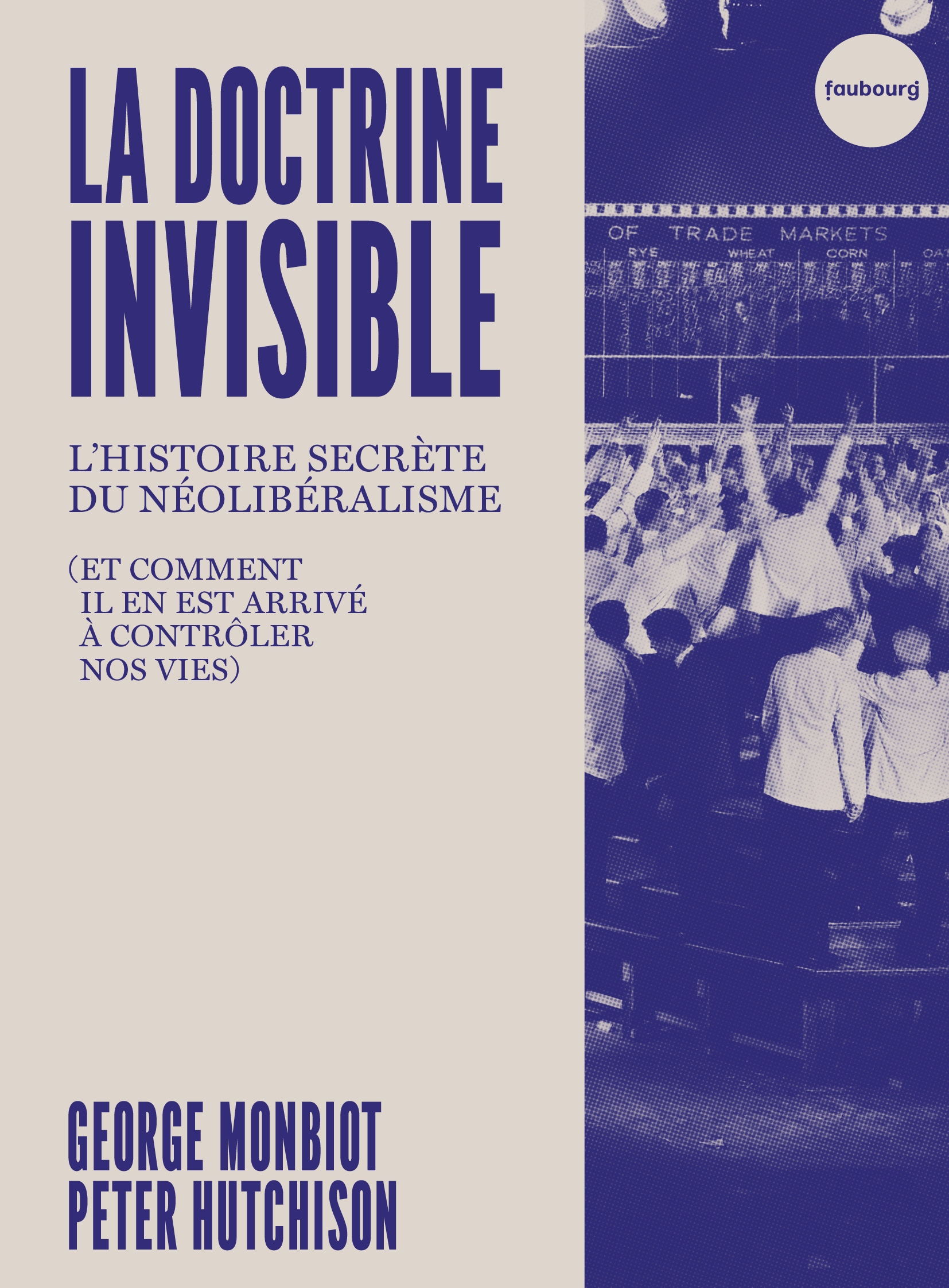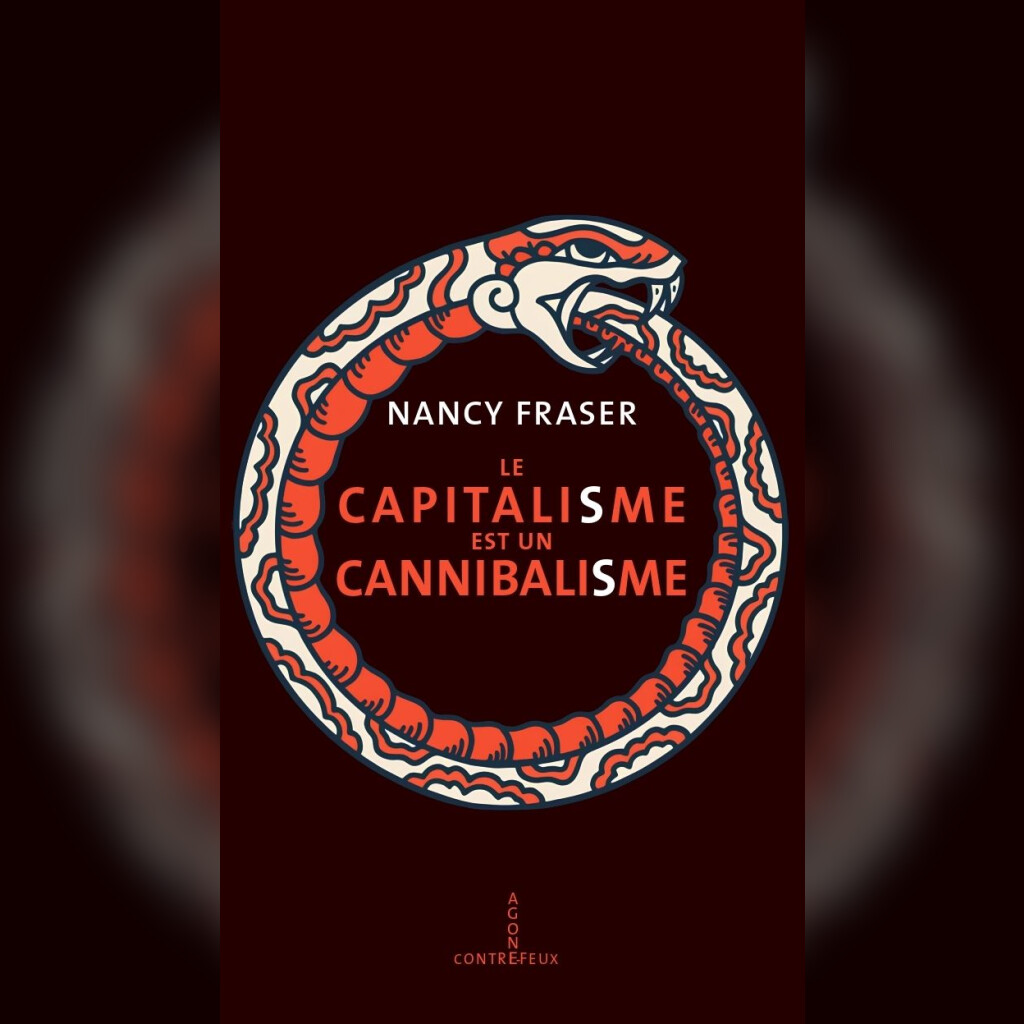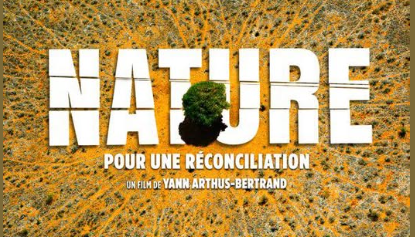Une fois n'est pas coutume, ce n'est pas d'un essai que nous vous parlons ici mais du premier rapport thématique consacré à la transition écologique que vient de publier la Cour des Comptes.
Le constat est implacable : le réchauffement s’accélère, les écosystèmes s’effondrent, les ressources s’épuisent. En 2024, les catastrophes liées au climat ont coûté près de 300 milliards d’euros à l’échelle mondiale, et la France pourrait perdre 11 points de PIB d’ici 2050 si elle reste sur sa trajectoire actuelle. Pourtant, malgré ces chiffres alarmants, les réponses demeurent timides et souvent incohérentes.
Certes, les émissions de gaz à effet de serre ont baissé de 30 % depuis 1990. Mais derrière cette statistique flatteuse se cache une réalité bien plus préoccupante : les émissions « importées » – générées par les biens que nous consommons mais produits ailleurs – continuent de croître et échappent à toute régulation. La France se satisfait d’une vision tronquée de sa responsabilité climatique.
La biodiversité décline, les nappes phréatiques s’épuisent, les déchets augmentent… Et pourtant, les politiques engagées restent fragmentées, souvent privées de moyens et freinées par l’absence d’indicateurs fiables. La création du Secrétariat général à la planification écologique (SGPE), censée donner une cohérence interministérielle, s’est traduite par une influence limitée, affaiblie par le poids d’autres priorités politiques et budgétaires.
Sur le plan financier, la Cour rappelle que l’effort consenti reste dérisoire au regard des besoins. La stratégie pluriannuelle de financement (Spafte), présentée en 2024, est jugée incomplète, trop technique, et surtout déconnectée de la réalité des collectivités et des territoires. Les investissements nécessaires – au moins 110 milliards d’euros supplémentaires d’ici 2030 pour le climat – reposent à 80 % sur le privé, alors que ménages et entreprises peinent déjà à absorber le coût des transformations.
Surtout, les choix opérés continuent d’entretenir les contradictions : subventions aux énergies fossiles, absence de trajectoires chiffrées pour certains secteurs, manque de transparence sur la réorientation des dépenses publiques. On parle de sobriété, mais on entretient encore des modèles économiques incompatibles avec les objectifs climatiques.
La Cour des comptes appelle à un sursaut : fixer des objectifs sectoriels clairs, évaluer réellement la capacité des ménages à supporter la transition, et surtout, mettre fin à l’inaction déguisée en action symbolique. Tant que l’État ne se dote pas d’une stratégie cohérente, courageuse et équitable, la France risque de continuer à reculer sous couvert d’avancer.
En filigrane, un mantra que l'on connait bien : nous n’avons plus le luxe d’attendre. Chaque retard aggrave la dette écologique et financière. L’inaction coûte plus cher que la transition, et pourtant, c’est encore la première qui domine.
COUR DES COMPTES - septembre 2025 - Lire la synthèse du rapport ici .