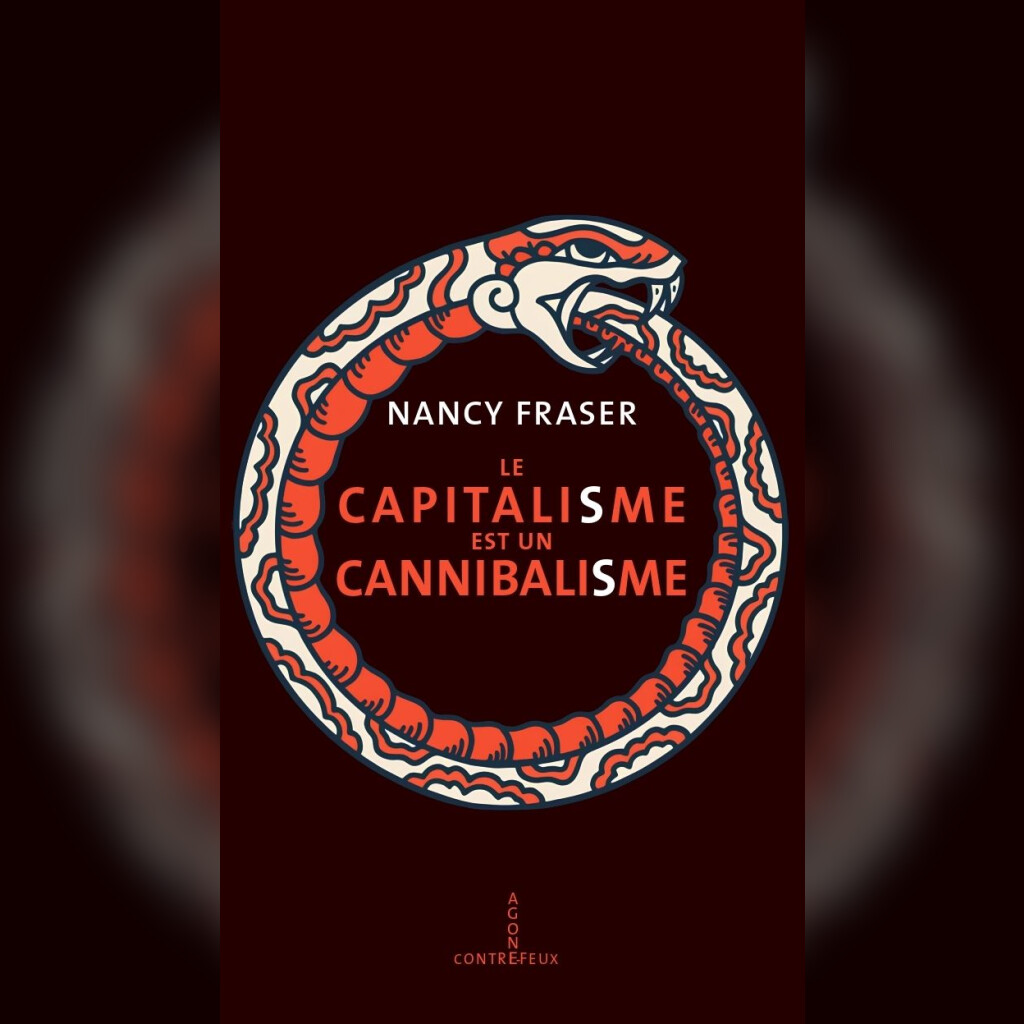Dans Le capitalisme est un cannibalisme, Nancy Fraser nous explique en quoi le capitalisme dépasse le simple système économique auquel on le réduit souvent et l'analyse comme « un ordre social entier » reposant sur la consommation systématique de ce qu’elle appelle les « quatre sphères non marchandes » : le travail domestique non rémunéré, la nature, les fonctions politiques, et les populations expropriées. De ces zones − indispensables à la production capitaliste − naissent les contradictions et les crises actuelles.
Une critique profonde des frontières imposées
Fraser s’inscrit dans une lignée critique post-marxiste, mais va bien plus loin. Elle identifie des « demeures cachées » : des zones pourtant essentielles, ignorées parce que non-marchandes ou non-capitalistes.
Ces frontières artificielles, construits socialement, sont à la fois invisibilisantes et destructrices. Elles permettent au capitalisme de puiser sans jamais compenser – reproduisant tant la dépendance écologique que le travail gratuit de care, la violence raciale ou l’aliénation politique.
Histoire d’un cannibalisme constant
L’originalité de Fraser est d’ancrer cette théorie dans une histoire du capitalisme en quatre phases : mercantile, libérale-coloniale, étatique-managériale, puis financiarisée. Ce cheminement historique montre comment les sphères non marchandes sont successivement prédatées selon les configurations sociales et technologiques du moment.
Intersectionnalité concrète et convergence politique
Le livre ne se contente pas d’analyser : il réclame une convergence émancipatrice entre les luttes antiracistes, féministes, écologiques et politiques. Fraser invite à dépasser l’intersectionnalité théorique pour penser les oppressions comme des sous-systèmes structurellement nécessaires au capitalisme – et donc à les combattre simultanément.
Le capitalisme et la nature : une contradiction inéluctable
Avec force, Fraser expose ce que l’on appelle la « contradiction écologique du capitalisme » : un système dépendant de la nature et de ses ressources, tout en la détruisant activement. Cette prédation écologique est au cœur de la dynamique capitaliste — et ce pillage structurel engendre à son tour des crises comme la pandémie récente, résultant notamment de dégradations écologiques.
Vers une écopolitique intégrée
Si le capitalisme nous « cannibalise » en épuisant les ressources physiques, sociales, politiques et humaines, alors la réponse ne peut être qu’intégrée.
Fraser appelle à une contre-hégémonie écopolitique, qui ne soit pas seulement environnementale, mais aussi sociale, politique, économique, et identitaire. Une contre-hégémonie capable de forger un sens commun mobilisateur au-delà des foules d’opinions diverses.
Des pistes concrètes — une socialisme renouvelé ?
Sans céder à l’utopie naïve, l’auteure esquisse les traits d’un socialisme du XXIᵉ siècle. Un socialisme qui ne se limite plus à la revendication d’une meilleure répartition économique, mais cherche à réinvestir les sphères non marchandes : soins, démocratie, nature… Elle refuse ainsi une approche fragmentée — ni écologisme réduit, ni féminisme détaché de la dimension sociale.
En conclusion
Le capitalisme est un cannibalisme est un ouvrage salutaire. Il nous pousse à reconnaître que la crise écologique ne peut être désolidarisée des violences patriarcales, racistes, politiques ou économiques. Ce livre est à lire comme un manifeste d’action : en convoquant tout, en reliant tout, il propose une voie collective pour reconstruire une société — et un monde — vivables.
Le Capitalisme est un cannibalisme de Nancy Fraser, aux éditions ANTIGONE-2025